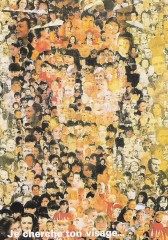Le ciel et la terre

Dieu a fait le ciel et la terre, dit la Bible.
Jésus a confirmé quand il dit : « … Entrez dans le Royaume prêt pour vous avant la création du monde ».
De nos jours nous appelons « la terre » : « l’univers »
Le Royaume est donc un autre univers !
A relire le psaume 103 et la liturgie, c’est l’Esprit saint qui est l’auteur de la loi de l’univers.
Il est donc aussi l’auteur de la loi du deuxième univers, celui qui est prêt à accueillir le premier cité avant que celui-ci ne commence !
On résume parfois « la terre », par « l‘homme et la femme » car c’est la chair de l’homme et de la femme qui est le sommet de l’évolution de l’univers.
On pourrait donc résumer le ciel par « l’ange » car au ciel on vit comme esprit ainsi que font les anges.
En revenant au début :
Dieu a fait le ciel et la terre,
Dieu a fait l’ange, l’homme et la femme.
Voilà la création.
Voilà comment nous l’avons su.
Le Père a envoyé son ange Gabriel
à sa fille Marie
pour lui faire comprendre qu’Il avait tout fait pour son Fils.
Marie a dit « qu’il me soit fait selon ta parole »
et le Verbe a reçu sa chair.
Le Fils a reçu le ciel et la terre !